UNE RUMEUR
Cela a commencé par une rumeur, qui s’est peu à peu amplifiée pour déboucher aujourd’hui sur un débat politique très vif et demain sur un projet de texte européen visant à alléger les contraintes, une directive dite « omnibus ».
Tout est parti de l’entrée en vigueur de la première vague d’application de la directive CSRD, qui impose aux grandes entreprises cotées et aux grands groupes cotés la publication d’un rapport de durabilité en 2025. Les efforts déployés par ces sociétés, qui pourtant en ont plus les moyens que d’autres, ont provoqué une prise de conscience de la lourdeur du dispositif, spécialement pour les entreprises qui font partie de la deuxième vague, les grandes entreprises non cotées qui seront tenues de publier un rapport en 2026, à plus forte raison pour celles, de moindre taille, qui suivront. Se sont ajoutées la perspective de devoir également préparer un plan de vigilance rénové en 2026 pour un grand nombre d’entre elles et la lourdeur des obligations imposées à certaines pour nourrir les nombreux indicateurs de la taxonomie de leurs activités.
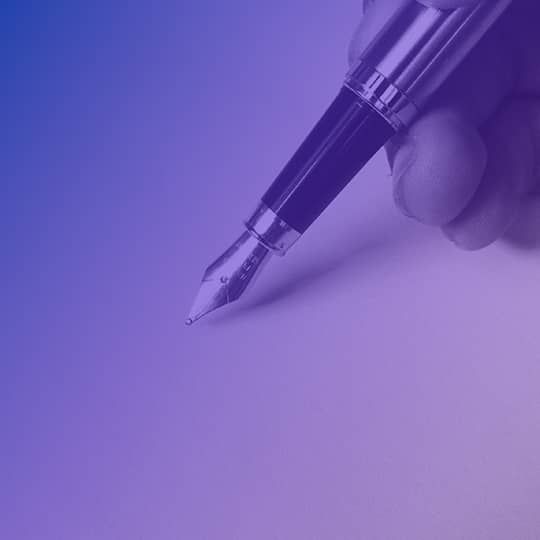
UNE FRONDE
Une fronde en est résultée de la part de nombreux acteurs économiques mais aussi politiques, en France et en Europe, fronde de surcroît exacerbée en France par le sentiment que le pays est un trop bon élève car s’il a transposé dans les délais les textes européens afférents, peu d’autres l’ont suivi : 17 Etats de l’Union n’ont toujours pas introduit la directive durabilité et la Commission leur a envoyé une mise en demeure.
Plusieurs pays ont publiquement manifesté leurs profondes réticences à l’égard de la lourdeur de ces obligations pour les entreprises, l’Allemagne en tête très vite suivie par d’autres, dont la France, et l’Europe n’a pas tardé à réagir. Certains Etats ou certains élus vont beaucoup plus loin : suspendre voire supprimer totalement les obligations de durabilité et de vigilance. C’est une idée évoquée par le Chancelier allemand, mais également par le Commissaire européen français compétent en la matière ; cependant, il semble, pour ce dernier, que son propos ait dépassé sa pensée.
DES RÉSISTANCES
Cette fronde a suscité une contre-offensive, non seulement des défenseurs du climat et de l’environnement, ce qui n’est pas surprenant, mais également d’une partie des milieux économiques, ce qui était moins attendu. Ainsi, par exemple, le Collège des directeurs du développement durable, le C3D, qui réunit plus de 380 directeurs de RSE de grands groupes français, a-t-il plaidé pour un maintien de principe de la directive CSRD et de son agenda.
Ils estiment que les règles de durabilité garantissent des conditions de concurrence équitables et, surtout, qu’elles renforcent la souveraineté européenne ; pour eux, c’est « le report ou la dilution de ces réglementations qui nuirait à la compétitivité de l’Europe et donnerait des avantages spécifiques aux normes étrangères ».
Toutefois, ils admettent que, pour les PME, certaines obligations pourraient être allégées et leur mise en œuvre rendue plus graduelle, et demandent, en contrepartie, que la mise en œuvre de la directive CSRD pour les entreprises non-européennes ayant des intérêts économiques en Europe soit avancée de deux ans (à 2027).
DES PROPOSITIONS FRANÇAISES
Le Gouvernement français a fait de nombreuses propositions dans un long document de 23 pages adressé à Bruxelles, daté du 20 janvier 2025, destiné à rester confidentiel mais révélé par la Presse.
La France voudrait, en premier, faire reporter un certain nombre de dispositions. Elle demande le report sine die l’entrée en vigueur de la directive vigilance, ce qui laisserait en vigueur la loi française au champ d’application bien moins large, et voudrait en second faire différer de deux ans la mise en œuvre de la directive durabilité. Elle demande également, pour les entreprises bancaires, que soit reportée d’une année supplémentaire l’entrée en vigueur des règles de maîtrise des risques des entreprises bancaires et financières, dites de « Bâle 3 », mais aussi que l’Autorité bancaire européenne (EBA) en fasse la toilette.
La France propose, en second, la création d’une catégorie intermédiaire d’entreprises, les ETI, et un allègement des contraintes de reporting à leur égard. D’autres textes sont visés, dont, entre autres, la réglementation du secteur agricole, pour l’alléger, et de l’intelligence artificielle, pour favoriser l’innovation.
Plus globalement, elle demande une stabilisation de l’environnement réglementaire, c’est-à-dire, en réalité, une pause.
La Compagnie des commissaires aux comptes a également fait des propositions par une lettre du 13 janvier 2025 à diverses instances (Commission, Gouvernement, H2A) : pour l’essentiel, ne pas relever les seuils mais simplifier les normes pour les mid-cap cotées et diminuer le nombre de points de reporting. D’autres autorités concernées ont également fait des propositions au début de l’année, ANC et AMF en particulier.

UN PROJET DE DIRECTIVE EUROPÉENNE
La Commission s’est emparée du sujet et envisage une directive dite « omnibus », comme il y en a déjà eu, qui pourrait porter tant sur la durabilité que sur la vigilance et pourrait même concerner le Règlement taxonomie. Elle devrait être présentée le 26 février 2025.
Quelles pourraient en être les orientations et le contenu ? Tout semble ouvert, mais quelques directions de réforme ont filtré.
Le projet pourrait reporter l’entrée en vigueur des directives durabilité et vigilance pour l’étaler sur une plus longue période et permettre ainsi aux entreprises concernées de s’y mieux préparer. La Commission serait également tentée de fondre ces deux textes en un seul, en particulier pour harmoniser les seuils, ce qui avait été proposé dans une étude très fouillée du HCJP de 2022. De récentes déclarations de la présidente de la Commission européenne, il semble même résulter l’idée d’une fusion des trois textes, taxonomie, durabilité et vigilance, pour les articuler et les harmoniser, mais à droit constant, sauf, a-t-elle néanmoins indiqué, pour « les obligations excessives », ce qui reste flou. Un tel regroupement aurait son intérêt mais ne serait pas une mince affaire et pourrait déboucher sur un monstre législatif.
Autre possibilité, qui n’est pas exclusive de la précédente, alléger les obligations des entreprises de taille moyenne, en particulier réduire sensiblement le nombre d’indicateurs (on parle de diviser par dix le nombres de normes ESRS).
Attendons le 26 février pour en savoir plus.

